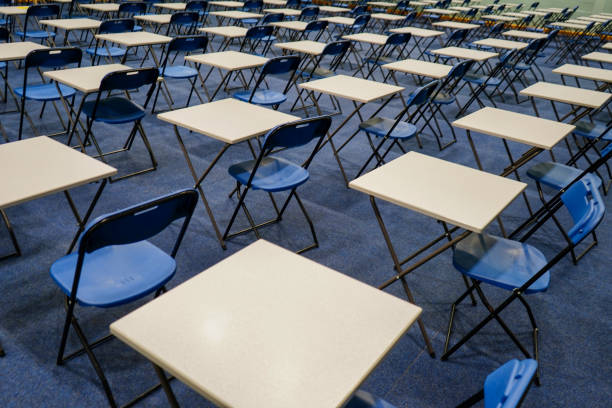91,8 % de réussite au baccalauréat en 2025. Voilà le chiffre triomphal affiché par le ministère de l’Éducation nationale. À première vue, la France semble réussir son pari éducatif : une génération presque entière qui décroche le fameux sésame vers l’enseignement supérieur. Une école républicaine qui tient ses promesses, en apparence. Et pourtant… La réalité, derrière ce pourcentage flatteur, est tout autre. Il masque un effondrement du niveau réel des élèves, une dévalorisation sans précédent du diplôme, et une crise silencieuse de l’école française. Un constat sévère, mais nécessaire.
Une mascarade statistique : du rite d’excellence à la certification automatique
Le baccalauréat n’a plus rien d’un examen rigoureux ou sélectif. Ce qui était autrefois un rite de passage exigeant et prestigieux est devenu une cérémonie d’autosatisfaction nationale, un simulacre de réussite orchestré pour garantir au plus grand nombre un diplôme vidé de sa substance. Le bac 2025 n’est plus l’épreuve qui distingue les efforts et les savoirs : il consacre désormais la politique du « tous reçus », au nom d’une inclusion mal comprise et d’une peur panique de l’échec scolaire.
Dans les années 1960, le baccalauréat était réservé à une élite scolaire. Seuls environ 10 à 15 % d’une génération obtenaient ce diplôme. Il s’agissait d’un examen national, rigoureux, anonyme, organisé autour d’épreuves longues, souvent orales, qui demandaient une maîtrise réelle des savoirs, de la langue et de la pensée argumentée.
Les dissertations de philosophie ou de lettres duraient 5 à 6 heures. L’orthographe, la syntaxe, la clarté d’expression étaient des critères de notation essentiels. Les épreuves scientifiques exigeaient rigueur, raisonnement logique, démonstrations complètes, sans calculatrice. Le redoublement n’était pas stigmatisé : il était perçu comme une étape normale dans un cursus où l’on formait des citoyens instruits, pas des candidats formatés. Aujourd’hui, plus de neuf élèves sur dix obtiennent le diplôme, sans que cela ne signifie qu’ils possèdent le niveau de langue, de culture ou de méthode que leur exigera l’université, le monde du travail ou même simplement la citoyenneté éclairée.
Depuis la réforme Blanquer, 40 % de la note finale repose sur le contrôle continu, c’est-à-dire sur des évaluations faites par les enseignants au fil de l’année. En soi, cela pourrait sembler raisonnable. Mais en pratique, cela se traduit par : des pressions constantes pour éviter les mauvaises notes, sous peine de conflits avec les familles ou la hiérarchie ; des évaluations parfois arrangées, où l’on note plus la présence et l’obéissance que la compréhension et la maîtrise ; un effacement de l’examen terminal, qui n’est plus le lieu de la confrontation à un savoir extérieur, mais l’achèvement d’un processus administratif.
Les sujets d’examen sont eux aussi simplifiés, guidés, adaptés. On supprime les épreuves jugées trop discriminantes. On privilégie des consignes fléchées, des contenus réduits, des exercices fragmentés. L’objectif n’est plus d’évaluer la pensée, mais de valider mécaniquement une scolarité. Les consignes de correction ont suivi le même mouvement : on incite à valoriser le moindre effort, à ignorer les fautes de français, à récompenser des bribes de réponses. Le correcteur devient un sauveteur. On ne sanctionne plus l’erreur, on tente de rattraper coûte que coûte l’élève, quitte à trahir le sens même de l’évaluation.
Ce n’est plus un diplôme qui certifie une maîtrise réelle de connaissances ou une aptitude à poursuivre des études exigeantes, mais un papier qu’on délivre pour éviter les tensions sociales et les mauvais chiffres ministériels.
Le naufrage post-bac : quand l’université devient le lieu de l’échec programmé
On pourrait croire qu’avec 91,8 % de réussite au bac, les bacheliers français entrent dans l’enseignement supérieur forts, confiants et bien préparés. Mais ce qui les attend, c’est bien souvent une confrontation brutale avec la réalité de leur propre niveau, et l’effondrement d’un système qui les a envoyés là sans armes intellectuelles ni outils méthodologiques.
Contrairement à l’illusion républicaine du « bac pour tous », l’université reste un lieu exigeant — du moins sur le papier. Résultat : les étudiants fraîchement diplômés, issus de filières générales comme technologiques ou professionnelles, s’y retrouvent largués dès les premiers mois.
Plus de 50 % des étudiants en licence échouent ou abandonnent avant la fin de la 2e année. Dans certaines filières comme STAPS, psychologie ou droit, le taux d’échec en première année dépasse 60 à 70 %. Le syllabus universitaire suppose une autonomie, une rigueur, une capacité à lire, comprendre et rédiger que nombre de bacheliers n’ont tout simplement pas. Ce ne sont pas les étudiants qui sont paresseux ou inadaptés. C’est le baccalauréat qui les a trahis, en leur faisant croire qu’ils étaient prêts, alors qu’ils ne possèdent ni la méthode, ni les fondements conceptuels, ni la maîtrise linguistique pour tenir le rythme.
Le constat devient encore plus alarmant lorsqu’on s’intéresse au niveau réel des compétences linguistiques et intellectuelles des bacheliers. De plus en plus d’enseignants tirent la sonnette d’alarme : nous avons des diplômés qui sont, en pratique, des illettrés.
Analphabétisation fonctionnelle : incapacité à résumer un texte de plus de 10 lignes, difficulté à comprendre des consignes complexes, fautes graves et récurrentes dans les copies, absence de structure argumentative, confusion des idées, copier-coller de fragments mal digérés. Un nombre croissant de jeunes adultes ne parvient pas à produire un texte cohérent sans faute. Et pourtant, ces mêmes élèves ont « réussi » le bac. Que valide donc ce diplôme, si ce n’est la tolérance institutionnalisée envers l’ignorance de base ?
Le système scolaire s’acharne à produire des chiffres flatteurs, des réussites artificielles, pendant que l’université fait le sale boulot : rattraper, recaler, orienter, parfois abandonner. Elle devient l’endroit où l’on dit enfin aux jeunes la vérité qu’on leur a cachée pendant des années : tu n’as pas le niveau.
C’est une violence sociale redoublée, car elle frappe des étudiants souvent issus des milieux populaires, à qui l’on a promis une ascension sociale par la réussite scolaire — mais sans jamais leur donner les moyens d’y parvenir réellement. Ce système fabrique de la frustration, du décrochage, du renoncement, et parfois même de la honte. Il est profondément inégalitaire.
Le grand mensonge de l’égalité : une école à deux vitesses
Le baccalauréat prétend incarner l’idéal républicain d’égalité des chances. En réalité, il camoufle une fracture sociale de plus en plus béante. Derrière le chiffre rassurant de 91,8 % de réussite se cache une école profondément inégalitaire, où les parcours sont radicalement opposés selon l’origine sociale, le territoire, ou le niveau de capital culturel.
On célèbre souvent la massification du bac comme une avancée sociale majeure : en 1960, seuls 10 % d’une génération décrochaient le diplôme, contre plus de 90 % aujourd’hui. Mais cette comparaison est trompeuse. L’unification de l’accès n’a pas entraîné l’unification de la qualité. On a ouvert les portes, mais pas nivelé les conditions d’apprentissage.
Dans les lycées de centre-ville, notamment les grands établissements urbains, les élèves bénéficient encore d’un encadrement rigoureux, de filières d’excellence, d’enseignants expérimentés, et parfois de stratégies scolaires familiales très actives.
Ailleurs, dans les lycées de banlieue, de zones rurales ou de réseaux d’éducation prioritaire, les élèves doivent souvent composer avec des classes surchargées, un turnover massif d’enseignants, un accès inégal à la culture et aux ressources extrascolaires, et des programmes appauvris.
Ce qui est vendu comme une même réussite dissimule en fait des réalités éducatives incompatibles. Deux bacheliers 2025 peuvent présenter le même diplôme mais n’ont parfois ni le même niveau, ni la même préparation, ni les mêmes chances de réussir la suite.
L’école française, loin de corriger les écarts sociaux, les amplifie. Et cela dès les premières années de la scolarité. Les enfants des classes moyennes et supérieures bénéficient dès le départ de tout ce qui compte : vocabulaire riche, environnement stimulant, soutien familial, maîtrise des codes scolaires implicites. Quand il le faut, les familles pallient les lacunes du système par des cours particuliers, du soutien privé, ou un recours stratégique à l’offre scolaire.
À l’inverse, les élèves issus de milieux populaires sont souvent orientés très tôt vers des filières moins valorisées, parfois contre leur volonté, dans une logique de gestion des flux. La machine à trier fonctionne avec une régularité implacable, sous couvert de neutralité.
Et pourtant, tous ces élèves, à la sortie, obtiennent le même bac. C’est là que réside la grande illusion égalitaire : ce diplôme unifié donne l’apparence d’une équité qui, dans les faits, n’existe plus.
Autrefois, le baccalauréat avait une fonction sélective : il attestait d’un niveau de culture générale, de maîtrise linguistique, d’autonomie intellectuelle. Aujourd’hui, il ne permet plus de différencier les profils, car la quasi-totalité des élèves l’obtiennent.
Les entreprises n’en tiennent plus compte dans leurs recrutements. Les universités organisent leurs propres tests ou filtrent dès Parcoursup. Le diplôme a perdu sa valeur sélective, donc son rôle social.
Cette disparition de la sélection formelle n’a pas supprimé la sélection réelle : elle l’a simplement déplacée. La vraie sélection se fait désormais en amont, par l’origine sociale, le lieu de résidence, la capacité à naviguer dans un système opaque.On a donc remplacé l’exigence par l’apparence. Et sous couvert d’égalité, on a figé les inégalités.
Il est encore temps : retrouver le sens de l’école
Le baccalauréat à 91,8 % de réussite n’est pas le signe d’un progrès éducatif : c’est le symptôme d’un renoncement collectif. Un chiffre qui rassure les ministères, flatte les bilans, apaise les parents, mais qui ne protège ni les élèves, ni la société. Derrière cette apparente démocratisation se cache une réalité glaçante : un diplôme vidé de sa substance, des étudiants perdus, des enseignants désabusés, et une jeunesse qu’on laisse avancer dans le brouillard.
Nous avons construit un système où l’exigence est devenue suspecte, où l’on confond bienveillance et laxisme, et où l’on croit défendre les plus fragiles en abaissant les seuils plutôt qu’en élevant tous les élèves. Mais il n’est pas trop tard.
Ce n’est pas de plus de chiffres flatteurs que l’école a besoin, mais de courage politique, de rigueur pédagogique et de confiance dans l’intelligence des élèves. Une école qui ose dire la vérité, qui ose former, qui ose exiger — non pour exclure, mais pour élever.
Il est temps de reconstruire une éducation nationale qui :
- Remet le savoir au cœur de sa mission
- Redonne à ses enseignants les moyens et l’autorité nécessaires
- Protège les élèves non pas du réel, mais des illusions
- Et réaffirme que l’égalité ne consiste pas à donner à tous le même diplôme, mais à offrir à chacun les moyens de penser librement
La crise du bac n’est pas une fatalité. C’est un appel.
Un appel à ne plus trahir les promesses de l’école républicaine.
À lire pour aller plus loin
- “L’École malade de la République” – Jean-Paul Brighelli
Une critique virulente de la dégradation du niveau scolaire en France, analysant les causes de l’échec du système éducatif et ses conséquences sur le diplôme du bac. - “L’École ou la guerre civile” – Pierre Bourdieu
Un essai fondamental qui dévoile comment le système scolaire reproduit les inégalités sociales sous couvert d’égalité formelle, notamment à travers les diplômes. - “Le Travail de la connaissance” – François Dubet
Analyse la massification scolaire et la perte de sens des diplômes dans un système qui valorise la certification plus que le savoir réel. - “L’École en voie de changement” – Philippe Meirieu
Une réflexion pédagogique qui alerte sur les dérives actuelles et propose des pistes pour restaurer l’exigence et la qualité dans l’enseignement. - “L’École contre la démocratie” – Philippe Meirieu
Un ouvrage qui questionne le rôle de l’école dans la société française, en mettant en lumière les tensions entre massification, démocratisation et sélection.