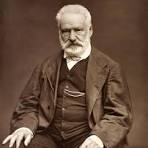Apparu dans les années 1960 et actif jusqu’au début des années 1980, le féminisme de la deuxième vague constitue une rupture majeure dans l’histoire des luttes pour l’égalité femmes/hommes. Là où la première vague féministe (fin XIXe – début XXe) s’était concentrée sur l’obtention de droits civiques et politiques – droit de vote, droit d’accès à l’éducation ou à certaines professions –, la seconde vague étend le champ de bataille. Les féministes de cette période n’aspirent plus simplement à être reconnues juridiquement comme des citoyennes à part entière. Elles revendiquent une transformation structurelle de la société : du droit au travail à la liberté sexuelle, en passant par la reconnaissance des violences, tout est remis en question.
Une révolution du quotidien : vers une émancipation globale
Ce mouvement s’inscrit dans un contexte socio-historique propice : essor de la société de consommation, montée des contestations sociales (Mai 68 en France, mouvement des droits civiques aux États-Unis), arrivée massive des femmes sur le marché du travail, progrès technologiques (comme la pilule contraceptive, autorisée en France dès 1967). Ces changements soulignent un décalage : les femmes ont un rôle actif dans la société, mais restent soumises à des normes patriarcales qui les relèguent à l’espace domestique, aux tâches reproductives et au silence.
Les revendications de cette deuxième vague féministe touchent tous les aspects de la vie quotidienne :
- L’égalité professionnelle et salariale, encore largement illusoire malgré la participation croissante des femmes à la vie économique.
- La dénonciation des discriminations sexistes dans la sphère publique comme dans la sphère privée.
- Le combat pour la libre disposition du corps féminin, incluant le droit à la contraception et à l’avortement. En France, ces luttes aboutissent à la loi Veil en 1975, dépénalisant l’IVG.
- La reconnaissance des violences sexistes et sexuelles, longtemps tues ou minimisées (viol conjugal, harcèlement, inceste).
- La critique des rôles sociaux traditionnels, qui assignent les femmes à la maternité, à l’épouse soumise ou à l’objet de désir.
Les militantes dénoncent un système global : le patriarcat, qu’elles analysent comme un pouvoir structurel ancré dans toutes les institutions (école, famille, médecine, médias, droit…).
Le personnel est politique…
Slogan fondateur de la deuxième vague, « Le personnel est politique » résume la démarche intellectuelle et militante. Ce qui se passe dans la sphère intime – le couple, le foyer, la sexualité, l’éducation des enfants – n’est pas un espace neutre ou privé, mais un lieu de reproduction des inégalités de genre. Ce slogan signifie que les souffrances individuelles des femmes (épuisement, culpabilité maternelle, solitude conjugale, violences) ont une dimension politique : elles révèlent une domination structurelle et doivent être rendues visibles, discutées et combattues publiquement.
Ce glissement est révolutionnaire. Il permet aux femmes de déconstruire les normes, de parler de ce qui était jusque-là indicible, et de s’émanciper en repensant leur propre subjectivité.
Pratiques militantes et structuration du mouvement
Cette vague féministe se traduit par une explosion de formes d’engagement :
- Création de groupes féministes non mixtes, favorisant la parole libre et la sororité.
- Occupation de l’espace public par des manifestations, happenings, collages, campagnes d’affichage.
- Naissance d’une presse féministe, comme Les Cahiers du féminisme ou Questions féministes, ainsi que d’une pensée théorique foisonnante, entre sociologie, psychanalyse, philosophie et littérature.
- Structuration de réseaux d’entraide, notamment pour soutenir les femmes ayant recours à l’avortement clandestin avant 1975.
En France, le MLF (Mouvement de libération des femmes) devient un acteur majeur de cette période. Il refuse toute hiérarchie, se veut horizontal, radical, et profondément novateur dans sa manière d’organiser la lutte. Aux États-Unis, la National Organization for Women (NOW) milite pour l’égalité dans le travail, l’éducation, et la vie politique.
Figures intellectuelles majeures
Plusieurs intellectuelles jouent un rôle essentiel dans la théorisation et la diffusion des idées féministes de la deuxième vague.
- Simone de Beauvoir, avec Le Deuxième Sexe (1949), propose une analyse existentielle du rapport entre les sexes. Elle affirme que « l’on ne naît pas femme, on le devient », soulignant que la féminité est une construction sociale et non une essence.
- Betty Friedan, aux États-Unis, publie The Feminine Mystique (1963), qui dénonce « le malaise sans nom » ressenti par les femmes enfermées dans la domesticité des banlieues américaines.
- Kate Millett, avec Sexual Politics (1970), développe l’idée que la sexualité elle-même est un lieu de domination.
- Monique Wittig ou Christine Delphy, en France, déconstruisent la notion de « nature féminine » et analysent le patriarcat comme une classe sociale.
Un impact durable sur les sociétés contemporaines
La deuxième vague féministe a profondément transformé nos sociétés :
- Des lois ont été votées, non seulement sur l’avortement, mais aussi sur l’égalité salariale, le harcèlement, le viol ou la contraception.
- Les normes sociales ont évolué : la maternité n’est plus perçue comme une obligation, les femmes accèdent massivement aux études supérieures, les tabous autour de la sexualité et des violences se lèvent peu à peu.
- Une pensée féministe diversifiée s’est déployée, ouvrant la voie à la troisième vague (à partir des années 1990), plus attentive à l’intersectionnalité, à la diversité des vécus (race, classe, orientation sexuelle), et à la critique des normes de genre.
Pourtant, de nombreuses luttes entamées à cette époque restent inachevées : les inégalités salariales persistent, les violences conjugales restent massives, les femmes continuent à assumer une charge mentale disproportionnée. Le combat est loin d’être terminé, mais la deuxième vague a changé à jamais le regard porté sur les femmes, leur corps, leur parole et leur liberté.
📚 À lire pour aller plus loin :
- « Le Deuxième Sexe » – Simone de Beauvoir
→ Un texte philosophique fondamental pour comprendre la construction sociale de la féminité. - « La Femme mystifiée » (The Feminine Mystique) – Betty Friedan
→ Une critique du modèle patriarcal américain dans l’après-guerre, révélatrice du malaise féminin. - « Ne nous libérez pas, on s’en charge » – Collectif
→ Recueil d’archives et d’analyses sur les luttes féministes des années 1970 en France.