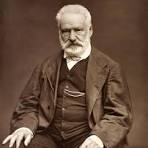Introduction
Le féminisme de la troisième vague émerge dans les années 1990, en réaction aux limites perçues des mouvements précédents. S’il ne s’agit pas d’une rupture absolue avec les premières et deuxièmes vagues, cette nouvelle génération introduit des thèmes, des méthodes et des figures profondément marqués par la diversité, la subjectivité et les mutations culturelles de la fin du XXe siècle. C’est un féminisme éclaté, pluriel, critique, en dialogue constant avec les multiples identités.
Genèse d’une troisième vague
Le terme « troisième vague » apparaît notamment sous la plume de Rebecca Walker en 1992, dans un article célèbre intitulé Becoming the Third Wave. Fille de la romancière et militante Alice Walker, elle incarne cette génération qui, tout en héritant des conquêtes juridiques des aînées, ressent la nécessité de lutter contre les discriminations systémiques encore à l’œuvre, particulièrement celles liées à la race, à la sexualité ou à la classe sociale.
À cette époque, les médias décrètent parfois que le féminisme est dépassé, voire mort. Mais dans les marges, dans les campus, dans les mouvements queer, les revendications se réorganisent. Cette nouvelle vague ne veut plus d’un féminisme perçu comme homogène, essentiellement blanc, bourgeois et hétérocentré.
Un féminisme de l’intersectionnalité
L’un des apports majeurs de la troisième vague est la prise en compte de l’intersectionnalité, un concept proposé par la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw. Il s’agit de penser ensemble les différentes formes d’oppressions — sexisme, racisme, homophobie, classisme, validisme — comme étant liées et non hiérarchisables.
Dans cette logique, être une femme ne suffit plus à faire communauté : on ne vit pas le sexisme de la même manière selon que l’on est blanche ou racisée, riche ou précaire, hétérosexuelle ou lesbienne. Le féminisme de la troisième vague n’a de cesse de déconstruire les prétendues évidences du sujet « femme » universel.
Le corps comme lieu de résistance
Les féministes de la troisième vague investissent le corps comme espace de lutte mais aussi d’affirmation individuelle. Elles s’emparent des codes de la beauté, de la sexualité, de la mode, de la pornographie pour en faire des terrains de réappropriation.
Le féminisme de la troisième vague refuse les injonctions contradictoires, notamment celles qui pèsent sur le corps féminin dans les médias de masse. Certaines militantes choisissent de s’épiler, de se maquiller, d’exhiber leur sexualité, d’autres non. Le féminisme devient alors une affaire de choix personnels revendiqués comme politiques.
Cette position a été critiquée : certaines féministes y voient une dérive individualiste, postmoderne, voire compatible avec les logiques libérales et capitalistes. Mais pour les militantes concernées, il s’agit de brouiller les normes, de revendiquer la multiplicité des formes de vie féminines et féministes.
Figures emblématiques et expressions culturelles
Cette troisième vague est incarnée par une grande diversité de figures : bell hooks, Judith Butler, Jennifer Baumgardner, Julia Serano, Roxane Gay, ou encore des artistes comme Bikini Kill, Tori Amos ou Missy Elliott. Elles utilisent la littérature, la musique, le cinéma, le théâtre et même l’humour pour porter des discours féministes souvent subversifs.
Les zines, ces petits fanzines autogérés, deviennent des supports d’expression très populaires dans les années 1990, notamment dans les mouvements riot grrrl, où musique punk et féminisme radical s’entremêlent. Ce sont aussi des lieux de prise de parole pour des jeunes femmes racisées, lesbiennes ou trans, trop généralement invisibilisées dans les circuits militants classiques.
Une critique du féminisme « mainstream »
La troisième vague refuse de se laisser récupérer par un féminisme institutionnalisé ou « respectabilisé ». Elle critique les dérives d’un féminisme de vitrine, porté par certaines figures médiatiques blanches et aisées, qui oublient les luttes sociales de terrain.
On reproche parfois à ce féminisme d’être trop éclaté, trop relativiste, voire incohérent. Mais ses défenseuses affirment qu’il n’y a pas un seul féminisme, mais des féminismes, que les femmes ne sont pas un bloc homogène, et que la contradiction fait partie de la vie politique.
Les débats internes et les tensions
Ce féminisme n’est pas sans conflits internes. Des débats virulents surgissent sur la prostitution, la pornographie, le port du voile ou la question trans. Certaines féministes dites radicales, qui dénoncent les violences patriarcales dans toutes leurs dimensions, s’opposent à celles qui prônent un féminisme « pro-sexe » ou favorable à la reconnaissance des identités de genre multiples.
Ces conflits ne sont pas nécessairement des signes de faiblesse : ils traduisent une volonté de ne pas figer le féminisme, de le confronter sans cesse à ses contradictions, à ses angles morts, à ses privilèges.
Héritages et prolongements
Le féminisme de la troisième vague a ouvert la voie à des formes de militance plus inclusives, plus expérimentales, et parfois très ancrées dans les réseaux numériques. Il a préparé le terrain pour ce que certains appellent une quatrième vague, marquée par les hashtags viraux, les appels à la sororité numérique, les dénonciations de violences sexistes sur internet.
Mais il demeure difficile de tracer une frontière nette : certaines autrices et militantes refusent cette logique de vagues successives et préfèrent parler d’un féminisme en évolution permanente, fait de circulations, de résurgences, de métamorphoses.
Conclusion
La troisième vague féministe ne propose pas une nouvelle doctrine ni un programme unifié. Elle est au contraire une invitation à penser l’émancipation dans la complexité du monde contemporain. Elle nous rappelle que le féminisme n’est pas un héritage figé, mais un mouvement vivant, pluriel, contestataire, ouvert aux multiples voix.
Elle nous pousse à envisager les identités comme mouvantes, les luttes comme imbriquées, et la parole comme un outil de transformation individuelle autant que collective. Ce féminisme, parfois mal compris, reste un levier précieux pour renouveler les formes de résistance, en accord avec la diversité des vécus.
À lire pour aller plus loin
- Judith Butler, Trouble dans le genre – Un texte phare qui interroge la construction du genre et les normes de la troisième vague.
- bell hooks, Ne suis-je pas une femme ? – Une critique fondamentale du féminisme blanc et une voix intersectionnelle majeure.
- Chimamanda Ngozi Adichie, Nous sommes tous des féministes – Un essai court, clair et accessible qui explore les continuités du féminisme contemporain.