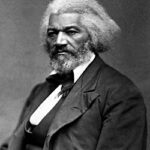Le féminisme de la première vague émerge à la fin du XIXe siècle et s’étend jusqu’au début du XXe siècle. C’est le socle fondateur des luttes pour l’émancipation des femmes dans les sociétés occidentales modernes. Ce mouvement, souvent qualifié de libéral et réformiste, cherche à étendre aux femmes les droits déjà acquis par les hommes dans un contexte marqué par l’essor des démocraties libérales, l’industrialisation et la montée des revendications sociales. Le féminisme de la première vague ne renverse pas le système patriarcal, mais il pose les premières pierres d’une égalité juridique, en interpellant l’État sur sa promesse d’universalisme… dont les femmes sont alors exclues.
Un contexte en mutation : modernité et exclusions
Le XIXe siècle voit la transformation des sociétés rurales en sociétés industrielles, l’urbanisation rapide, l’essor de la bourgeoisie, et la multiplication des discours sur les droits, les libertés, la raison et la justice. Pourtant, les femmes restent largement exclues de ces mutations. Le suffrage universel masculin – obtenu en 1848 en France – exclut toujours la moitié de la population.
Le droit reste profondément inégalitaire : le Code civil napoléonien inscrit la femme mariée dans un statut de mineure, soumise à l’autorité de son mari. Elle ne peut ni voter, ni gérer ses biens, ni exercer une profession sans l’accord de son époux. Dans la sphère publique, elle est invisible ou infantilisée. Dans la sphère privée, elle est assignée au rôle d’épouse, de mère et de ménagère.
Ce féminisme naît donc dans un contexte d’injustice flagrante entre les idéaux proclamés par les révolutions démocratiques et la réalité du statut des femmes.
Un féminisme libéral et réformiste
La première vague féministe ne conteste pas fondamentalement les institutions : elle veut y intégrer les femmes. Elle s’inscrit dans la tradition des Lumières, en s’appuyant sur des concepts comme la raison, l’égalité, la liberté individuelle et l’universalité des droits. Ce féminisme est dit libéral car il se concentre sur les réformes légales et l’égalité devant la loi.
Les militantes ne réclament pas un bouleversement radical des rapports de genre, mais l’élargissement des droits civiques aux femmes, au nom de leur humanité et de leur citoyenneté.
Trois revendications centrales
- Le droit de vote : C’est la revendication emblématique de cette première vague. Les féministes réclament l’accès aux urnes comme symbole et instrument de reconnaissance politique. Le suffrage est un droit fondamental, qui conditionne l’accès à la citoyenneté. Pourtant, ce combat sera long. En France, les femmes devront attendre 1944 pour obtenir ce droit. Aux États-Unis, le 19e amendement garantissant le droit de vote aux femmes est adopté en 1920, après des décennies de lutte acharnée.
- L’accès à l’éducation et à certaines professions : De nombreuses femmes réclament le droit de s’instruire, de passer des examens, d’enseigner ou d’exercer des métiers intellectuels. En France, Julie-Victoire Daubié devient la première femme bachelière en 1861. Le combat se poursuit pour l’entrée dans les universités, les écoles de médecine ou de droit, puis dans les professions libérales.
- La reconnaissance juridique et civile : Les femmes veulent être reconnues comme des sujets de droit dans la sphère privée. Cela concerne la capacité juridique, le droit de gérer ses biens, d’hériter, de divorcer, de choisir son époux ou encore d’avoir la garde de ses enfants en cas de séparation. Ce sont des enjeux quotidiens, invisibles, mais cruciaux, pour conquérir une autonomie individuelle.
Des pratiques militantes structurées et courageuses
Le féminisme de la première vague est massivement porté par des femmes de la bourgeoisie instruite, souvent exclues de la politique, mais impliquées dans la vie intellectuelle ou philanthropique. Leurs outils sont variés :
- Création d’associations féminines (ligues pour le droit des femmes, sociétés suffragistes…).
- Rédaction de journaux militants, brochures et essais.
- Organisation de conférences, réunions publiques, pétitions et campagnes de presse.
- Manifestations et actes symboliques pour attirer l’attention des médias et des parlementaires.
- Lobbying politique, en écrivant aux élus, en rencontrant des députés ou des ministres.
Au Royaume-Uni, les suffragettes du Women’s Social and Political Union (WSPU), dirigées par Emmeline Pankhurst, adoptent des tactiques de plus en plus radicales : sit-in, bris de vitrine, grèves de la faim, afin d’imposer leur revendication dans l’espace public. Aux États-Unis, Susan B. Anthony est arrêtée en 1872 pour avoir voté illégalement : son procès devient un symbole de la lutte féministe.
Olympe de Gouges et les précurseures oubliées
Bien avant la fin du XIXe siècle, des femmes avaient déjà formulé des revendications féministes, sans qu’on les nomme ainsi à l’époque. La plus célèbre est Olympe de Gouges, autrice en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en réponse directe à celle de l’homme et du citoyen. Elle y affirme : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. » Elle y plaide pour le droit de vote, l’accès aux emplois publics, le divorce, la reconnaissance des enfants naturels. Guillotinée sous la Terreur, elle sera longtemps effacée de l’histoire.
D’autres figures, comme Mary Wollstonecraft (Vindication of the Rights of Woman, 1792) en Angleterre, Flora Tristan ou George Sand en France, posent déjà les bases d’une pensée égalitaire, mais leurs idées restent marginalisées.
Un féminisme de l’inclusion, pas encore de la subversion
Il est essentiel de souligner que la première vague féministe ne remet pas en cause les rôles traditionnels des femmes. Elle ne conteste pas l’idée que la maternité, le mariage ou la domesticité soient les fonctions naturelles des femmes. Elle ne théorise pas encore la sexualité, la charge mentale, la domination masculine ou le genre comme construction sociale.
De ce fait, elle reste centrée sur une élite blanche, instruite et bourgeoise, et ignore souvent les revendications spécifiques des femmes pauvres, des ouvrières ou des femmes racisées, qui luttent sur d’autres terrains.
Une victoire partielle mais fondatrice
Les gains de la première vague sont réels, mais limités. Le droit de vote est obtenu dans certains pays, mais toujours tardivement (1944 en France, 1971 en Suisse). L’éducation progresse, mais l’égalité réelle reste à conquérir. Pourtant, ce féminisme a permis une prise de conscience historique : les femmes peuvent et doivent être actrices de leur destin, prendre la parole, revendiquer des droits.
En ouvrant la porte à la citoyenneté, la première vague rendra possible les vagues suivantes. La deuxième vague, à partir des années 1960, interrogera plus profondément les structures sociales, les normes de genre, la sexualité et le patriarcat. Mais rien n’aurait été possible sans les pionnières de la première vague, qui ont posé les fondations du féminisme moderne.
📚 À lire pour aller plus loin :
- « Les premières féministes, 1830–1914 » – Christine Bard
→ Une référence en français sur les débuts structurés du féminisme en Europe. - « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » – Olympe de Gouges
→ Un texte révolutionnaire fondateur, écrit en 1791. - « Le féminisme au temps des suffragettes » – Claire Démar & Hubertine Auclert (textes choisis)
→ Recueil militant et historique de la parole féminine avant 1914.