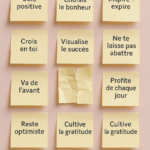Depuis le 27 septembre, le Maroc assiste à la naissance d’un mouvement que nul n’avait vu venir, mais que tout le monde redoutait. Sous le nom de « GenZ 212 », une jeunesse longtemps silencieuse a choisi de se lever, de parler, de contester, de nommer ce que d’autres taisaient. Ce soulèvement n’est pas né d’un slogan creux, ni d’un calcul politique. Il est né du réel, de la douleur, de la honte ressentie face à huit femmes mortes à Agadir, mortes en couches, dans un hôpital public censé leur donner la vie. Ces décès ont ouvert la digue. Derrière, tout un fleuve de colère contenue s’est mis à couler.
À travers les rues, dans les quartiers populaires, sur les places, dans les voix tremblantes des premiers rassemblements, un message s’est imposé : trop, c’est trop. Trop d’attente, trop de promesses, trop de corruption, trop de mépris. Cette génération n’a pas grandi dans la peur, mais dans l’incrédulité : celle de voir son avenir confisqué au nom d’une stabilité qui ne profite qu’à quelques-uns. Elle n’a pas de chef, pas de parti, pas de syndicat. Elle a des téléphones, des mots, des vidéos et cette foi nouvelle dans la puissance d’un collectif sans visage.
Un mouvement sans visage, mais pas sans conscience
GenZ 212 s’est formé sur Discord, sur TikTok, dans les espaces numériques où la parole échappe au contrôle institutionnel. C’est là que s’organisent les rassemblements, que s’échangent les informations, que naissent les appels à manifester. Une génération numérique, habituée à la fluidité des échanges, crée une contestation fluide, insaisissable, sans tête à couper. Les autorités, déconcertées, cherchent à identifier, à arrêter, à décoder, mais le mouvement glisse entre les doigts du pouvoir comme du sable entre les paumes.
Les revendications de ces jeunes ne sont ni révolutionnaires ni déraisonnables : elles sont vitales. Elles réclament des hôpitaux qui soignent, des écoles qui instruisent, des emplois qui permettent de vivre, des institutions qui servent au lieu de servir les mêmes. Elles réclament que l’argent public cesse d’être englouti dans des chantiers de prestige pendant que les campagnes s’enlisent dans la pauvreté. Elles réclament que l’on regarde enfin le Maroc des marges, celui des villages oubliés, des quartiers périphériques, des urgences sans médecins. Ce n’est pas une idéologie, c’est une demande de dignité.
La désobéissance comme devoir moral
La réponse du pouvoir, elle, oscille entre l’incompréhension et la répression. Des arrestations ont eu lieu. Des heurts ont éclaté. Des jeunes ont été blessés, d’autres ont disparu. Les témoignages parlent de violences policières, de surveillances, de contrôles arbitraires. Pourtant, malgré les risques, malgré la peur, les manifestants reviennent, encore et encore. Ils disent qu’ils ne sont pas là pour casser, mais pour se faire entendre. Ils ne demandent pas la chute du régime, ils demandent qu’on leur rende ce qui aurait dû leur appartenir depuis toujours : des droits élémentaires, une vie décente, une place dans leur propre pays.
« Penser, c’est désobéir », écrivait déjà une autre génération dans d’autres luttes. Cette formule trouve ici toute sa vérité. Car penser, dans un contexte où l’on attend la soumission, devient un acte de résistance. Ces jeunes n’ont pas seulement désobéi à l’ordre policier, mais à l’ordre mental : celui qui leur disait d’accepter, de se taire, de se contenter de survivre. Ils ont compris que la pensée n’est pas une posture, mais un mouvement intérieur qui pousse à dire non. Penser, c’est ne plus avaler l’injustice, c’est refuser les récits imposés, c’est reprendre la parole là où on la croyait confisquée.
Une génération qui refuse de se taire
Ce qui se joue au Maroc dépasse les simples revendications sociales. C’est une bataille symbolique pour la reconnaissance, une bataille de génération contre un système figé. GenZ 212 n’a pas de doctrine, mais il a une conscience. Il ne parle pas de révolution, mais de réparation. Il ne cite pas Marx, mais il revendique la transparence, la décence, la vérité. Ce n’est pas un mouvement idéologique, c’est un cri politique, un cri humain.
Les autorités parlent d’agitateurs, d’influence étrangère, de manipulation. Ce discours ancien ne trompe plus personne. L’influence étrangère n’a pas besoin d’exister pour que l’injustice soit réelle. Ce qui blesse ces jeunes, c’est de voir leur pays gaspiller ses forces dans des illusions de grandeur, pendant que les hôpitaux manquent de lits et que les écoles ferment faute de moyens. Ce qui les révolte, c’est de constater que la richesse du royaume n’irrigue pas la vie des citoyens. Ce qui les mobilise, c’est de savoir que leurs parents ont espéré en vain.
Désobéir, c’est réclamer la justice
La désobéissance, ici, n’est pas synonyme de chaos. Elle est au contraire un appel à la responsabilité. Elle demande à ceux qui gouvernent d’écouter, d’admettre que les chiffres officiels ne masquent plus les plaies. Désobéir, c’est rappeler que la légalité n’est pas toujours la justice, et qu’un peuple peut être fidèle à sa patrie tout en refusant ses injustices.
Mais désobéir, c’est aussi risquer. Risquer la répression, risquer l’isolement, risquer la trahison. Certains craignent déjà que le mouvement ne soit récupéré, d’autres redoutent qu’il s’épuise. L’absence de leadership peut être une force comme une faiblesse : elle protège de la récupération, mais rend le dialogue institutionnel plus difficile. Pourtant, il est clair que quelque chose a changé. L’indifférence n’est plus possible. Le silence n’est plus tenable.
GenZ 212 ne tombera peut-être pas un régime, mais il aura fissuré une façade. Il aura réveillé une génération, redonné le goût de la parole, de la critique, de la pensée. Et cela, aucun décret, aucune matraque, aucune coupure d’internet ne pourra l’effacer.
Le pouvoir de la pensée
Penser, c’est désobéir. C’est dire non à l’habitude, non à la peur, non à la résignation. C’est refuser de se taire quand des femmes meurent en donnant la vie, quand un pays riche en ressources laisse mourir ses pauvres dans l’indifférence. Penser, c’est croire encore en la possibilité de la justice, et s’obstiner à la réclamer.
Le Maroc, en cet automne 2025, n’est probablement pas au bord d’une révolution. Il est au bord d’une prise de conscience. Et cela, c’est peut-être pire pour le pouvoir. Car quand une génération commence à penser, elle ne s’arrête plus. Et quand elle pense ensemble, plus rien ne peut la faire taire.