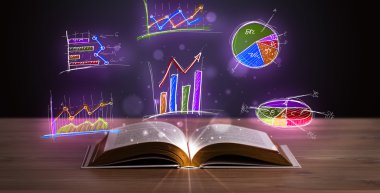Et si notre époque avait atteint ce paradoxe tragique : des cerveaux partout, mais de moins en moins de pensée ?
Jamais les sociétés humaines n’ont formé autant de diplômés, produit autant de données, généré autant de compétences, de calculs, d’analyses. Des générations entières apprennent à coder, à optimiser, à anticiper, à performer. Nous sommes formés à comprendre des systèmes complexes, à manipuler des symboles, à faire tourner le monde à grande vitesse.
Mais à quoi bon cette intelligence, si elle ne s’interroge plus sur ses finalités ?
Derrière les vitrines brillantes de la modernité — écoles d’élite, tours de la finance, open spaces de la tech, chaînes d’info en continu — se cache peut-être l’une des grandes impostures de notre temps : on ne valorise plus l’intelligence pour penser, mais pour exécuter.
Exécuter des tâches, des ordres, des algorithmes, des stratégies d’entreprise, des politiques d’austérité, des lignes éditoriales.
Penser, dans le vrai sens du terme — penser pour comprendre, relier, questionner, désobéir même — est devenu suspect. Trop lent. Trop complexe. Trop inutile.
Il ne faut pas remettre en cause, il faut “s’adapter”. Il ne faut pas ralentir, il faut “performer”. Il ne faut pas se poser de questions, il faut “produire”.
Dès lors, une question provocatrice s’impose : la finance fabrique-t-elle des crétins ?
Pas des ignorants, pas des incompétents — mais des esprits brillants, désintéressés du monde réel, réduits à des rouages efficaces dans une mécanique de profit.
Et cette question, qui aurait autrefois fait sourire dans les colloques universitaires ou les éditos engagés, mérite aujourd’hui d’être posée dans la rue, dans les écoles, dans les bureaux, dans nos familles.
Elle doit être posée ici, maintenant, au cœur de notre quotidien pressurisé, parce que ce quotidien lui-même en porte déjà les effets — dans nos manques de sens, dans nos burn-outs intellectuels, dans notre incapacité croissante à distinguer la connaissance du bavardage.
Une société saturée de compétences… et pauvre en conscience
Dans les tours de verre de la finance mondialisée, il n’y a pas de manque de cerveaux.
On y trouve une armée d’ingénieurs, de statisticiens, d’analystes de données, de diplômés des meilleures écoles. Tous parfaitement formés à l’art de prévoir les fluctuations des marchés, à modéliser les risques, à calculer les marges. Des esprits ultra-compétents, rigoureux, méthodiques.
Mais cette excellence, placée au service d’un seul impératif — le rendement — devient orpheline de toute finalité humaine.
À force de réduire le monde à des variables, la finance ne s’intéresse plus à la vie réelle :
Peu importe que les spéculations sur les matières premières affament des régions entières.
Peu importe que des pays s’écroulent sous les dettes contractées selon des règles qu’ils n’ont pas écrites.
Peu importe que des crises systémiques effacent des millions de vies en quelques clics de souris.
Ce qui compte, ce n’est pas le sens de l’opération. C’est sa performance.
Et dans cette logique, penser devient presque une gêne. Il ne faut pas réfléchir. Il faut exécuter.
Il ne faut pas se demander “à quoi bon ?”. Il faut faire “comme prévu”.
Ce modèle s’est peu à peu généralisé à tout le système : la finance en est la caricature, mais elle n’est pas la seule.
L’école a, elle aussi, peu à peu adopté cette logique : on n’y apprend plus à chercher, mais à réussir. À s’adapter aux attentes du marché, à cocher les bonnes cases, à passer les concours.
Même les matières littéraires, pourtant anciennes alliées de la pensée critique, se retrouvent dépossédées de leur dimension subversive. Elles deviennent des exercices de méthode, des grilles de lecture, des “compétences transférables”. L’élève devient un projet à rentabiliser.
Les médias, eux, ne forment plus des citoyens, mais des consommateurs d’attention. Ils réduisent la pensée à de la réaction, l’information à du défilement, la complexité à des punchlines. Le présent devient un flux d’événements, pas une matière à comprendre.
Ainsi se construit un monde dans lequel l’intelligence n’a jamais été aussi répandue et néanmoins, la pensée véritable y est presque absente.
Le formatage intellectuel comme outil de contrôle
Ce que nous vivons n’est pas un simple appauvrissement culturel. Ce n’est pas une négligence. C’est une stratégie systémique.
Le système actuel ne cherche pas à supprimer l’intelligence — il la reconfigure. Il la redirige. Il la vide de sa substance critique pour la remplir de fonctions techniques.
On ne veut pas des crétins au sens classique du terme. On veut des exécutants brillants : capables d’analyser, de coder, de parler anglais, d’innover… mais incapables d’interroger le sens de ce qu’ils font. C’est cela, la nouvelle figure du crétin : quelqu’un d’intelligent, mais désengagé intellectuellement. Quelqu’un qui pense dans un cadre, sans jamais remettre en cause ce cadre.
Trois piliers de cette fabrique :
1. La finance : un laboratoire du vide éthique
C’est l’archétype. On y parle de “produits dérivés”, de “valeurs mobilières”, de “bundles” toxiques, de “marchés à terme”… mais jamais de ce que ces abstractions produisent dans la vie réelle.
Le cynisme y est maquillé en neutralité : “ce n’est pas nous, c’est le marché”.
La responsabilité est dissoute dans l’algorithme.
La morale ? Irrationnelle. L’éthique ? Non-opérationnelle.
2. L’école : l’intelligence domestiquée
Le système scolaire, censé être le berceau de la pensée libre, est peu à peu devenu une fabrique de conformité.
On y récompense la vitesse, la discipline, la capacité à “rentrer dans le cadre”.
On y évalue l’élève à partir de compétences “transversales”, standardisées, quantifiables.
L’échec n’est plus un lieu d’apprentissage, il est un stigmate.
Penser en dehors des clous devient une prise de risque sociale.
3. Les médias : la pensée transformée en flux
La parole y est fractionnée, compressée, scénarisée.
- Une idée doit tenir en 280 caractères.
- Un propos complexe doit être “clivant” ou “buzzable”.
- Un débat d’idées doit avoir une chute, une émotion, un moment fort.
La profondeur est sacrifiée sur l’autel du rythme. Le contenu devient “format”, puis “conteneur vide”.
En résumé, ce système ne cherche pas l’idiotie, mais une forme d’intelligence docile, accélérée, désamorcée.
Il ne craint pas que les gens soient bêtes — il craint qu’ils pensent trop lentement, trop profondément, trop librement.
Ce n’est pas le niveau qui baisse, c’est la pensée qu’on dévie
Il faut cesser de poser le problème en termes de “niveau qui baisse” ou de “jeunesse décérébrée”. Ce diagnostic est non seulement paresseux, mais il masque l’essentiel : la pensée n’a pas disparu, elle a été réorientée.
On n’a pas supprimé la capacité à réfléchir — on l’a enfermée dans des couloirs.
On n’a pas éteint les esprits — on leur a imposé une lumière blanche, technique, froide.
On n’a pas détruit l’intelligence — on l’a instrumentalisée.
Le véritable enjeu n’est pas la “bêtise” en tant que telle. Il est dans le type d’intelligence qu’on produit et valorise :
- Une intelligence servile, efficace, rentable, « standardisable ».
- Une intelligence utile au système, mais inutile au sens.
- Une intelligence incapable de faire retour sur elle-même, d’interroger ses propres présupposés.
Penser, ce n’est pas résoudre des problèmes — c’est interroger leur légitimité
Le monde contemporain adore les « problem-solvers » : on veut des solutions, des résultats, des innovations.
Mais qui s’autorise encore à poser la question du problème lui-même ? Qui ose dire : “et si ce n’était pas ce problème qu’il fallait résoudre, mais les conditions qui l’ont rendu possible ?”
Penser véritablement, c’est parfois refuser de jouer, refuser de répondre, refuser de produire tout de suite. C’est prendre le temps d’un détour. D’un doute. D’une désobéissance.
Comme le disait Michel Foucault :
“Penser, c’est interroger ce qui va de soi.”
Le véritable enjeu : réhabiliter la pensée lente, critique, inutile
Car c’est bien cela qu’il faut défendre : une pensée inadaptée au système, improductive selon ses normes, mais vitale pour rester libre.
Une pensée inquiète, qui doute. Une pensée qui relie, qui regarde derrière les apparences, qui entend les silences. Une pensée qui résiste, non par agressivité, mais par lucidité.
Crétins performants ou citoyens pensants ?
Alors, la finance fabrique-t-elle des crétins ?
Pas de manière grossière, ni intentionnelle. Mais oui, elle participe à un système global où l’intelligence est mise au service du vide, où l’esprit critique devient un handicap, où la conscience ralentit la machine. Et ce système ne s’arrête pas aux salles de marché : il traverse nos écoles, nos écrans, nos institutions, nos vies.
Nous ne manquons pas de cerveaux. Nous manquons de lieux pour penser librement, de temps pour douter, de courage pour désobéir.
Le choix n’est pas entre être idiot ou intelligent.
Le vrai choix, aujourd’hui, est entre :
Une intelligence domestiquée, brillante, mais docile, qui sert des logiques qui nous dépassent et une pensée insoumise, qui accepte de ralentir, de dire non, de chercher autre chose.
Penser, c’est déjà désobéir.
Et désobéir, aujourd’hui, c’est peut-être notre dernier acte de lucidité.
À lire pour aller plus loin :
La société du spectacle – Guy Debord
La nouvelle raison du monde : Essai sur la société néolibérale – Pierre Dardot & Christian Laval
Ce que le digital fait de nos cerveaux – Michel Desmurget
La fabrique du crétin digital – Jean-Paul Brighelli
Philosopher, c’est désobéir – Barbara Stiegler & Guillaume le Blanc
L’enfant et la raison d’État – Pierre Bourdieu